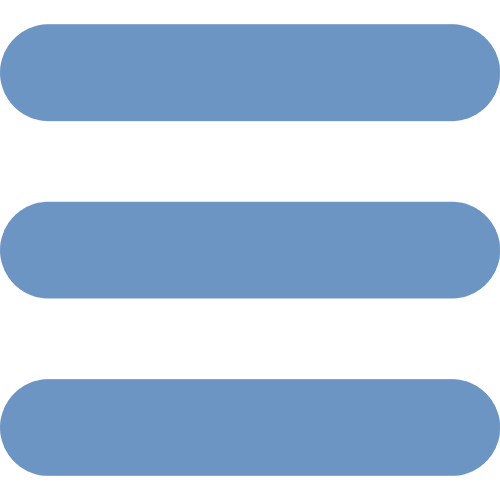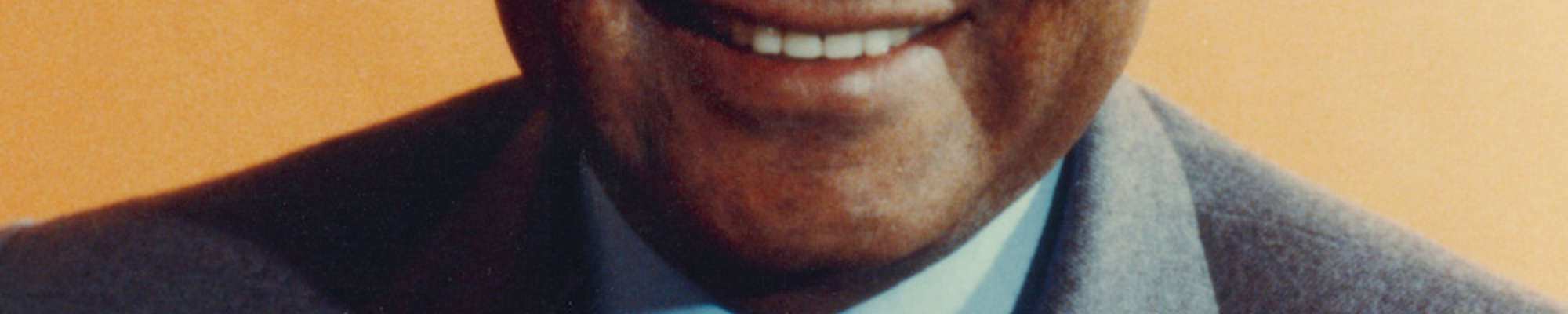Le Comité exécutif de l’AAFU a la douleur de vous faire part du décès d’Amadou Mahtar M’Bow, Directeur général de l’UNESCO de 1974 à 1987, survenu le 24 septembre dernier. Vous trouverez ci-dessous le communiqué de la Directrice générale, suivi d’une courte biographie.
Le Comité exécutif transmettra les condoléances que vous souhaiterez adresser à sa famille par le lien : d.afus@afus.unesco.org.
L’AAFU rendra hommage à Amadou Mahtar M’Bow dans le numéro de LIEN/LINK de novembre 2024.
Qu’il repose en paix.
Le Comité exécutif
----------------------------------
Message de la Directrice générale
« Humaniste convaincu et intellectuel complet, Amadou Mahtar M’Bow a profondément marqué notre institution en défendant avec force l’exigence de solidarité et d’égale dignité entre les peuples et entre les cultures. A l’heure des indépendances, il s’est aussi évertué à ce que chaque Etat trouve sa juste place à l’UNESCO, donnant chair et réalité à l’ambition du multilatéralisme. Nous lui devons notamment l’œuvre scientifique monumentale qu’est l’Histoire générale de l’Afrique, qui a donné au monde et plus particulièrement aux Africaines et aux Africains un moyen de s’approprier leur histoire et de se projeter vers l’avenir. A ses proches, à ses amis et à ceux nombreux, à l’UNESCO et ailleurs, qui voyaient en lui un modèle de pensée et d’action. »
Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO
----------------------------------
Courte biographie de A.M M’Bow
Né à Dakar en 1921, Amadou Mahtar M’Bow a été ministre de l’éducation, de la culture et de la jeunesse du Sénégal, participant activement à la vie politique du pays, et Directeur général de l’UNESCO pendant 13 ans. « L’itinéraire qui a conduit le petit paysan du Sahel africain à la tête de l’une des plus prestigieuses Organisations des Nations Unies est peut-être exemplaire de l’émergence d’un autre monde longtemps asservi, méprisé sinon ignoré, celui des peuples déshérités », écrivait le journaliste et futur diplomate Pierre Kalfon lors de l’élection de M. M’Bow au poste de Directeur général. Le jeune Amadou est admis à l’école coloniale après avoir d’abord fréquenté l’école coranique, et suit ensuite le « cours commercial » de la Chambre de commerce de Dakar avant de réussir le concours de commis de l’administration coloniale. Engagé volontaire en métropole en 1940, il retourne au Sénégal après la défaite française. Quatre ans plus tard, il participe au débarquement de Provence et participe à la libération de la France.
Après des études d’histoire à la Sorbonne, le jeune professeur rentre au pays en 1951, et enseigne pendant deux ans avant d’être chargé de créer et de diriger l’éducation de base au Sénégal et en Mauritanie. Ministre de l’éducation et de la culture pendant la période d’autonomie interne (1957-1958), il démissionne pour s’engager dans la lutte pour l’indépendance. Une fois l’indépendance acquise par le Sénégal, il devient ministre de l’éducation nationale (1966-1968), puis de la culture et de la jeunesse (1968-1970) et député à l’Assemblée Nationale.
Nommé Sous-Directeur général de l’UNESCO pour l’éducation en 1970, il est élu Directeur général en 1974, mandat qu’il assume jusqu’en 1987 après avoir été réélu en 1980. Son action à la tête de l’UNESCO, est axée sur deux grandes priorités : la promotion du consensus comme mode de décision collective au sein de l’UNESCO, et la défense de l’indépendance de la fonction publique internationale.
Amadou Mahtar M’Bow fait part de sa « conviction profonde que le monde est un et que le combat pour l’homme est partout le même ». Pour lui, « l’humanité est condamnée à vivre dans l’ère de la solidarité, si elle ne veut pas connaître celle de la barbarie ».
Amadou Mahtar M’Bow plaide aussi avec force en faveur d’un « Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication » - l’information internationale étant alors exclusivement fournie par cinq grandes agences de presse toutes situées en Europe et en Amérique du Nord avec pour conséquence que le flot de nouvelles circule essentiellement du Nord vers le Sud.
L’ère M’Bow est marquée par des initiatives durables telle que le Programme international pour le développement de la communication (PIDC) créé en1981, le Comité du patrimoine mondial, institué par la Convention du patrimoine mondial de 1972 et établi en 1976, qui a fortement contribué à la renommée de l’UNESCO, et deux ans plus tard, le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale.
C’est aussi sous le mandat d’Amadou Mahtar M’Bow que sont désignées les premières réserves de biosphère, aires protégées reconnues par l'UNESCO comme régions modèles conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable.
Article paru dans la revue Lien 146
Hommage au pédagogue universel des racines profondes
La sagesse africaine ancienne nous enseigne que « dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s’embrassent ». Les branches symbolisent la riche diversité des peuples du monde, les racines, les valeurs universelles qui fondent l’unité de leur humanité commune. Les troncs des arbres sont les sociétés, les lieux de vie où, dans la tension permanente, l’unité de leur humanité illumine la diversité de leur identité plurielle. Dans l’angoisse de l’expérience de la guerre, de la prégnance profonde de l’inhumanité qu’elle traduit, derrière le masque et la posture d’une prétendue civilisation, les pères et mères fondateurs de l’UNESCO déclarèrent dans son Acte constitutif, avec une conviction certainement tremblante : « Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Face à l’hécatombe de la Première Guerre mondiale, Sigmund Freud avait déjà lancé un avertissement à la civilisation occidentale : « Le problème n’est pas que nous soyons tombés aussi bas, mais que nous n’ayons jamais été aussi haut que nous le pensions. »
Dans l’Acte constitutif de l’UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow a reconnu la sagesse africaine qui l’a nourri : Neet neeteye garabam, ce qui signifie L’humain est le remède de l’humain. Le Directeur général qu’il est devenu a inscrit cette valeur fondamentale au cœur de son mandat, donnant sens et substance à l’humanité qui irrigue et éclaire le « vivre ensemble » du peuple sénégalais, dans l’interfécondation permanente de ses communautés. « L’éducateur aux pieds nus » du programme libérateur « L’Éducation de base » – qui a fleuri dans les interstices de la domination coloniale de l’époque – a en permanence puisé dans les valeurs de sa société traditionnelle. À l’école de la vie des villages du Sénégal profond, s’est alors forgée en lui une éthique universelle d’écoute, de partage et de respect de l’Autre. La « solidarité morale et intellectuelle », valeur fondatrice de l’UNESCO, a donc fait résonance dans toute sa personne.
L’expérience de l’inhumanité coloniale et de la violence raciste de la Seconde Guerre mondiale a suscité, dans les profondeurs de sa conscience d’homme, une interrogation ontologique, comme chez les fondateurs de l’UNESCO, sur la réalité et la signification profonde du concept de « civilisation ». À ce concept, qui a légitimé la « mission civilisatrice » dont s’est drapée la colonisation européenne pour dominer et exploiter – et dont son peuple a été victime –, Amadou Mahtar M’Bow a répondu au cours de son mandat en tant que Directeur général par la proclamation du « Temps des peuples » et la promotion, par l’éducation, la science, la culture et la communication, de la construction de « l’humanité commune » des racines universelles qui s’embrassent dans la diversité de leur expression.
Centralité de l’éthique, promotion du patrimoine commun de l’humanité, respect de la vérité historique, construction permanente du consensus entre nations, justice, égalité pluralisme… Amadou Mahtar M’Bow a convoqué toutes ces forces essentielles au rendez-vous du « vivre ensemble » que l’UNESCO a la vocation unique de construire. Deux actions majeures de ses mandats en témoignent, qui resteront inscrites dans la mémoire éthique de l’Organisation : le refus de licencier les fonctionnaires de nationalité américaine après le retrait de leur pays de l’UNESCO, la défense sans faille des fonctionnaires arrêtés par leur gouvernement, et la libération de militants politiques détenus par les dictatures militaires d’Amérique du Sud. Souvent, dans la plus haute solitude, il est « resté debout au milieu de la tempête », selon la belle formule du poète turc Nâzim Hikmet, habité par le diom (dignité et courage) de son peuple. Jamais il n’a séparé son savoir d’intellectuel de la sensibilité de son cœur.
Conscient de la construction à bas bruit d’une société mondiale de contrôle et de surveillance, Amadou Mahtar M’bow s’est alors engagé pour que l’UNESCO donne, grâce à ses programmes, sens et substance à ces valeurs de justice, d’égalité et de pluralisme, afin de dévoiler les nouveaux masques de la domination intellectuelle et idéologique qui proclame le caractère inéluctable d’un conflit des civilisations et de la fin de l’Histoire. Le mandat ontologique et fécond de l’UNESCO — « [...] c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix » — a ainsi toute sa légitimité. C’est, en effet, sur le terrain intellectuel et éthique de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication que doivent être édifiés les contrefeux aux concepts toxiques dominants de surdétermination des valeurs matérielles du « marché », de clôtures identitaires comme le « grand remplacement », qui nourrissent les agendas politiques de partis et de mouvements d’extrême droite, aujourd’hui aux portes du pouvoir dans un nombre croissant de pays. Ce sont ces mêmes forces de domination et d’influence que les États membres demandèrent au Directeur général Amadou Mahtar M’Bow de combattre par le Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication (NOMIC).
Ainsi, dans le temps long de son histoire, l’UNESCO est au défi de redonner vie, sens et substance à la « solidarité morale et intellectuelle » que son Acte constitutif a proclamée comme valeur centrale de construction de la paix dans l’esprit des hommes. Le successeur et ami d’Amadou Mahtar M’Bow, Federico Mayor, a quant à lui creusé encore plus profondément ce sillon fécond, en valorisant une éthique de la résistance par le biais du programme « Culture de la paix ».
Pour l’heure, l’UNESCO doit inscrire dans son champ de réflexion et d’action la nécessité intellectuelle, historique et éthique de « problématiser » le concept de « civilisation », et de promouvoir la valeur ontologique et intemporelle de « l’humanité ».
Doudou Diène